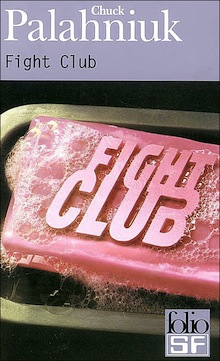 Fight Club. Depuis 1996 et 1999, respectivement dates de sortie du livre de Chuck Palanhiuk et du film de David Fincher, ce nom est mythique, légendaire presque. Quelle claque en effet que ce film et pourtant, ce n’est rien, strictement rien par rapport au livre qui m’en a asséné une encore plus intense, peut-être aussi parce que je suis un peu plus âgé et donc plus à même d’interpréter le dessous du livre et le destin destructeur de Tyler Durden et de son pendant schizophrénique (à moins que ce ne soit l’inverse).
Fight Club. Depuis 1996 et 1999, respectivement dates de sortie du livre de Chuck Palanhiuk et du film de David Fincher, ce nom est mythique, légendaire presque. Quelle claque en effet que ce film et pourtant, ce n’est rien, strictement rien par rapport au livre qui m’en a asséné une encore plus intense, peut-être aussi parce que je suis un peu plus âgé et donc plus à même d’interpréter le dessous du livre et le destin destructeur de Tyler Durden et de son pendant schizophrénique (à moins que ce ne soit l’inverse).
« Laisse-moi te parler de Tyler. Tyler dit : les choses que tu possèdes finissent toujours par te posséder. C’est seulement après avoir tout perdu que tu es libre de faire ce dont tu as envie. Le fight club t’offre cette liberté. Première règle du fight club : Tu ne parles pas du fight club. Deuxième règle du fight club : Tu ne parles bas du fight club. Tyler dit que chercher à s’améliorer, c’est rien que de la branlette. Tyler dit que l’autodestruction est sans doute la réponse. »
Ecrit il y a presque 15 ans, ce roman n’a pas pris une foutue ride et paraît même de plus en plus tangible puisque le monde est toujours au bord du chaos, n’ayant toujours pas trouvé de révolution, de cause commune ou autre émulateur mondial qui permettrait à notre douce civilisation de dépasser sa connerie endémique.
L’écriture de Chuck Palanhiuk n’y est surement pas étrangère, j’ai en effet retrouvé la dynamique, le cynisme, la violence et la construction des phrases que j’avais adorés dans Peste, son dernier roman (ou avant-dernier, mais bref). Tout comme dans Peste qui nous dépeint une société du chaos, Fight Club nous décrit lui aussi le chaos, mais à venir, qui monte, qui monte, qui monte pour finalement exploser dans une société au bord du gouffre.
Bref, au delà de la claque littéraire qu’a représenté et représente toujours ce livre, Fight Club est une description sans pitié de ce qui pourrait bien nous arriver faute de nous libérer de certaines de nos chaînes. Autrement dit, c’est sacrément mal barré.





